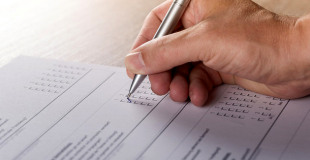Certificat d’état des risques naturels : explications !

Le certificat d’état des risques naturels fait partie des dix diagnostics immobiliers obligatoires. Celui-ci revêt davantage un caractère informatif, les habitants ne pouvant que prendre connaissance du degré de risque naturel, mais en aucun cas agir en conséquence. Sur quels fondements est-il constitué ? Pourquoi est-il mis en place ? Et dans quels cas est-il obligatoire ? Réponses.
Pourquoi un certificat des risques naturels ?
Le certificat d’état des risques naturels doit répondre du degré d’exposition d’un logement à quatre risques dits naturels. Pour chacun d’eux, un plan de prévention est consultable auprès de la collectivité territoriale.
L’exposition au risque minier
Le risque minier est lié à l’évolution des cavités souterraines et des vides résiduels à proximité des anciens sites miniers abandonnés ou non entretenus, après que l’exploitation ait cessé. En quoi ces évolutions représentent-elles un risque ? Parce que les mouvements de terrains peuvent provoquer des affaissements ou des effondrements. Les sites miniers représentaient une surface incroyable de cavités souterraines, où il fallait creuser toujours davantage pour extraire des matériaux précieux, comme de l’or, du charbon, de l’uranium, etc. Plus ou moins profondes, ces cavités présentent un risque réel pour les habitations. Certaines mines n’ont pas fait l’objet de travaux de mise en sécurité suffisants, pouvant provoquer des effondrements localisés comme une sorte d’entonnoir d’éboulement, des effondrements plus généralisés lorsqu’un terrain cède littéralement, ou des affaissements lorsque des travaux en profondeur sont opérés à proximité.
Le risque est donc bien réel pour la sécurité, voire même pour la survie des occupants. L’habitation peut subir de graves dégâts qui affecteraient alors largement sa solidité, voire provoqueraient son effondrement. Les réseaux d’accès et d’évacuation d’eaux, d’électricité ou de gaz peuvent aussi être détériorés. Enfin, le risque réel pourrait également entraîner une pollution de l’eau, des inondations par remontée des eaux en cas d’affaissement, des explosions gazeuses, des émissions de gaz toxique ou même radioactif.
Dans le cas d’un risque minier, les zones à risque délimitées par un Plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers résiduels seront connues des habitants. Ce plan de prévention est approuvé par la Préfecture.
L’exposition au risque sismique
Il faut savoir que le risque sismique existe partout, sur chaque m² du globe. Et oui, surtout avec toutes ces évolutions climatiques, personne ne peut se prévaloir de ne pas être exposé à ce risque. En revanche, certaines zones y sont plus exposées que d’autres, et ce à cause de leur proximité avec l’une des frontières des plaques de la couche terrestre, qui sont plus impactées lors de frottements au niveau des failles. S’il y a d’abord la secousse principale à l’épicentre, il y a ensuite ce que l’on appelle les répliques, qui peuvent malheureusement être très meurtrières. On définit un séisme par sa magnitude, qui traduit l’énergie libérée sous forme d’ondes sismiques, et par son intensité, qui mesure les effets et les dommages du séisme sur un lieu en particulier. L’intensité est constatée sur place par observation.
Si la planète a connu de puissants séismes dans son histoire, notamment en Guadeloupe et en Martinique pour ne parler que des territoires français, de nombreux petits séismes se produisent également quotidiennement, sans que cela n’ait beaucoup d’impact sur le quotidien. En revanche, cela n’empêche pas les bâtiments de connaître des dégâts, comme évidemment des fissures dues aux mouvements du sol.
Le risque sismique est gradué de 1 à 5, 1 signifiant que le risque est très faible, donc qu’il n’y a pas de prescription parasismique particulière, et 5 que le risque est accru et où des règles parasismiques sont applicables à tous les nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens, comme aux autres équipements type barrages, ponts, industries nucléaires ou encore sites classés Seveso. L’état indiquera donc le niveau sismique attribué à la commune. Sachez enfin qu’en cas de sinistre, les préjudices causés par les séismes sont couverts par les assureurs au titre de la garantie « catastrophes naturelles ».
L’exposition potentielle au radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les roches. Le décor est posé, le mot « radioactif » était de trop pour poursuivre cette lecture sereinement… Rassurez-vous, il est en fait présent partout à la surface de la Terre, mais à des concentrations variables. Le risque réside donc dans sa concentration trop importante qui, s’il est inhalé quotidiennement, peut augmenter le risque de cancer du poumon, et plus largement de pathologies respiratoires, comme l’asthme, les sinusites, etc. par sa fixation sur les aérosols de l’air qui viendront se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation. Il est reconnu cancérigène par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), en prenant la triste seconde place des principales causes du cancer du poumon, derrière le tabac et devant l’amiante.
Si certains sols en sont davantage imprégnés, le risque réside plutôt dans la mauvaise aération du logement, ce qui provoquera la concentration du gaz. En extérieur, il n’est pas nocif, ou disons plutôt qu’il se dissout rapidement. Une cartographie du potentiel radon des communes existe donc et répartit le risque en 3 zones d’exposition, selon le type de sol.
L’exposition aux risques technologiques
Le risque technologique est lié à la potentialité qu’un aléa d’origine technologique ou industrielle, donc issu d’une activité humaine, se produise. Plus précisément, le risque réside dans la manipulation, le transport et le stockage de substances dangereuses pour la santé et pour l’environnement. Il regroupe donc les risques pris sur le secteur de la production d’énergie sur les centrales nucléaires, les barrages hydroélectriques, etc., sur le secteur de l’extraction sur les forages, les échouages ou encore les marées noires, etc.
On se souvient encore de la triste catastrophe vécue à Toulouse en 2001 avec l’explosion de l’usine AZF et de près de 300 tonnes de nitrate d’ammonium, et plus récemment l’incendie de l’usine de Lubrizol à Rouen en 2019 qui a entraîné l’échappement de plus de 5000 tonnes de produits chimiques. Les premiers exposés sont les employés, puis les secours. Selon l’ampleur de la catastrophe, la population résidant aux alentours peut également être touchée, lui donnant alors un caractère d’urgence sociale et sanitaire.
La directive Seveso impose la mise en place d’un classement des sites industriels selon le risque et le niveau de danger pris, que l’on dénombre à plus de 1300 en France. Egalement, la loi « Risques » de 2003 a instauré un Plan de prévention des risques technologiques (PPRT) approuvé par la Préfecture, qui répertorie les zones délimitées à risque.
Vous l’aurez compris, l’état des risques naturels, de son nom complet Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques (ERNMT) est une information préventive des risques sur la zone concernée. Instauré par la loi du 30 juillet 2003, il est établi sur les informations délivrées de chacun des plans de prévention approuvés par la Préfecture de Région. Des arrêtés préfectoraux sont édités, listant notamment les communes concernées par chacune de ces expositions.
Comment s’établit un certificat d’état des risques naturels ?
Contrairement à l’ensemble des diagnostics immobiliers faisant partie du Dossier de Diagnostic Technique propre à un bien immobilier, l’état des risques naturels ne nécessite pas l’intervention d’un diagnostiqueur pour être édité. En effet, là où ce dernier intervient habituellement pour déceler la présence d’amiante, de termite ou encore un risque d’atteinte à la sécurité des occupants du logement sur la non-conformité de l’installation électrique ou gaz, son intervention n’est pas nécessaire concernant l’exposition aux risques naturels.
Ces derniers sont consultables librement en mairie. Des arrêtés préfectoraux listent les communes à risque selon l’un des 4 facteurs précités. Aussi, le propriétaire peut lui-même s’informer auprès de la mairie de sa commune, puisque le risque est environnemental. Il ne touche pas une seule habitation. C’est un risque pris dans cette zone géographique.
L’état des risques peut donc être rempli directement via un formulaire en ligne, accessible depuis le site du Ministère chargé de l’environnement, qui pourra être complété grâce aux informations contenues dans l’arrêté préfectoral.
Quand est-il obligatoire ?
Le certificat d’état des risques naturels est un document obligatoire pour pouvoir vendre ou mettre en location un bien immobilier. Après avoir complété, daté et signé le formulaire d’état des risques naturels subis sur la zone d’implantation du bien, le vendeur devra annexer l’exemplaire original à la promesse de vente ou à l’acte de vente, et en conserver une copie. Il devra dater de moins de 6 mois lors d’une vente, le niveau de risque attribué pouvant évoluer sur la zone.
Ajoutons également qu’en cas de sinistre dû à l’un de ces facteurs naturels, le vendeur sera tenu d’indiquer au potentiel acheteur l’indemnité perçue et les circonstances du sinistre. Une mention devra être portée à l’acte de vente.
Dossiers similaires
-
Carte professionnelle d’agent immobilier : doit-on l'exiger à son agence ? Suite à la publication de la loi Hoguet, Tout agent immobilier doit détenir une carte professionnelle depuis le 20 juillet 1972. Celle-ci atteste de son droit de réaliser certains types...
-
Diagnostic amiante : explications ! Est-il obligatoire pour vendre un bien immobilier ? Véritable enjeu de santé publique, l’élimination de l’amiante est l’un des combats des pouvoirs publics, mais aussi des associations de lutte contre le cancer, dont il est l’une des causes...
-
Quels sont les diagnostics immobiliers obligatoires pour vendre son bien ? Les diagnostics immobiliers ont pour but d’informer l’acheteur sur certains aspects du logement. Ils doivent impérativement être réalisés par un professionnel certifié.Lors de la vente...
-
Droit de préemption : définition, fonctionnement, recours Selon la définition donnée par le Conseil supérieur du notariat, le droit de préemption est le "droit légal prioritaire d'achat au bénéfice des particuliers et de certaines collectivités...
-
Information sur les mérules : explications ! Est-elle obligatoire pour vendre un bien immobilier ? Du fait d’un manque ou d’un mauvais entretien, ou simplement par négligence, certaines pièces restent fermées et ne sont pas suffisamment aérées. Ces facteurs sont propices au développement...
-
Vendre un bien immobilier : 10 conseils pour réussir ses photos Si vous projetez de vendre un bien immobilier, il vous faut réaliser de belles photos pour accompagner votre annonce de vente. Les photos sont en effet un élément important de la mise en vente,...
-
Vente d'un bien : quels éléments sont exclus de la surface habitable ? Un bien immobilier d'habitation doit répondre à ce que l'on appelle des critères de décence. Il est en effet interdit de vendre, mais aussi de louer, un logement qui ne remplit pas certaines...
-
Vendre son bien immobilier actuellement en location : comment faire ? Vous êtes le propriétaire d’un bien immobilier, maison ou appartement, que vous avez placé en location. Vous souhaitez le mettre en vente et vous vous demandez si vous en avez le droit et...
-
Quelle différence entre un mandataire et un agent immobilier ? Peut-être que vous avez déjà constaté la concurrence féroce à laquelle se livrent les mandataires immobiliers agissant pour un réseau et les agents immobiliers.Bien que ces deux professionnels...
-
Compromis de vente entre particuliers ou sous seing privé : tout savoir ! Contrairement à l’acte définitif de vente qui doit être signé devant notaire et nécessite son intervention, le compromis de vente peut tout à fait être signé et rédigé d’un commun...
-
Diagnostic pour assainissement non collectif : explications ! 5 millions de logements français ne sont pas raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, soit environ 15 % du parc national. Aussi, ils ont l’obligation de disposer d’un système...
-
Comment devenir mandataire immobilier : quelle formation, quelles qualités ? Devenir mandataire immobilier est une possibilité pour bon nombre de particuliers, puisqu’aucun diplôme n’est demandé. Néanmoins, c’est une profession qui exige des formations spécifiques,...